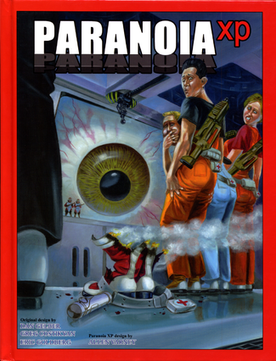« La Tunisie a rejoint le modèle historique général »
Interview d’Emmanuel Todd
Que vous inspire la chute du régime Ben Ali ?
Notre livre montrait que, contrairement au discours dominant d’un islam considéré comme incompatible avec la modernité, le monde musulman connaissait un phénomène rapide de modernisation éducative et démographique. De vastes régions musulmanes ont vu leur taux de fécondité tomber entre 2 et 2,3 enfants par femme (le taux de la France ou des Etats-Unis étant de 2 enfants par femme). Une évolution déterminante, car l’histoire montre la concomitance de trois phénomènes : alphabétisation, baisse de la fécondité et révolution. L’Iran, par exemple, a fait sa révolution de 1979 au moment où son taux d’alphabétisation atteignait celui des Français du Bassin parisien en 1789. Or, pour Youssef Courbage et moi-même, dans ce modèle, la Tunisie représentait une bizarrerie. Son taux de fécondité y est le plus faible du monde arabe (2 enfants par femme, en 2005) et l’alphabétisation y est quasiment achevée : pour la période 2000-2004, 94,3% des 15-24 ans savent lire et écrire (97,9% pour les garçons et 90,6% pour les filles). Dès lors, la longévité d’un régime autoritaire semblait alimenter les théories qui prétendent que le monde arabe serait incapable de se moderniser. La raison que nous avions trouvée, c’était le niveau élevé d’endogamie qui, en Tunisie, était nettement supérieur à 30% au milieu des années 90, alors que l’Iran, l’Algérie et le Maroc étaient à 25% et la Turquie à 15%. Or, il y a un rapport entre endogamie et structure politique: l’étanchéité du groupe familial entraîne la fermeture des groupes sociaux sur eux-mêmes et la rigidité des institutions.
Que s’est-il passé ?
L’hypothèse de l’endogamie était probablement la bonne, mais elle doit être nuancée par une analyse fine des données dont nous disposons. «L’enquête tunisienne sur la santé de la mère et de l’enfant de 1996» (1) marque une chute du taux des mariages entre cousins germains : 36% pour les couples mariés depuis plus de trente ans, 20,5% pour les unions célébrées durant les quatre années précédant l’enquête. On peut supposer que la tendance s’est poursuivie. Autrement dit, l’hypothèque de l’endogamie a été levée, permettant à la baisse de la fécondité et à l’alphabétisation de jouer pleinement leur rôle. Avec cette révolution, la Tunisie a rejoint le modèle historique général et quelles que soient les difficultés à venir (et il y en aura, bien sûr), l’idée d’un retour en arrière est difficilement concevable.
Vous avez rappelé l’exemple de la révolution iranienne qui, devenue islamiste, s’en est prise aux femmes. La Tunisie ne court-elle pas le même risque ?
Dans la France au XIXe siècle comme en Iran aujourd’hui et dans la Tunisie de demain, la stabilisation démocratique pose des problèmes de transition. Pour l’heure, les islamistes semblent hors-jeu en Tunisie, mais il serait absurde de se crisper si certains d’entre eux devaient intégrer le processus démocratique. N’oublions pas que l’émergence des démocraties anglo-saxonnes a été associée à un concept religieux - en l’espèce, le protestantisme. De nos jours, au cœur de l’Europe moderne, la CDU allemande est explicitement chrétienne. Quant aux pays musulmans, on observe que la Turquie démocratisée est dirigée par des islamistes modérés proeuropéens, qui s’accommodent fort bien de la hausse de l’alphabétisation et de la baisse de la fécondité - à la grande surprise des laïcs français, mais non des Anglo-Saxons. Quant au statut de la femme, il était partie prenante d’un système familial patrilinéaire qui exige que le fils succède au père. Mais, lorsque le taux de fécondité tombe à 2 enfants par femme, nombreux sont les pères qui n’ont pas de garçon et c’est tout le système qui s’effondre. En réalité, dans de tels pays, et malgré la focalisation sur le port du foulard, le discours islamiste d’abaissement des femmes ne mord plus sur la réalité.
La Tunisie va-t-elle devenir le laboratoire du monde arabe ?
Peut-être la Tunisie va-t-elle faire passer le monde arabe de l’autre côté du miroir et rendre caduc le sempiternel discours sur l’incapacité structurelle des pays arabes à devenir des démocraties. Plusieurs éléments plaident en ce sens : la démographie, l’éducation, la présence massive de la culture française et l’absence de pétrole - à partir du moment où il y a du pétrole, le régime rentier peut échapper à sa population. Regardons deux pays sur la liste des mutations à venir : en Syrie, le taux d’alphabétisation est encore plus élevé qu’en Tunisie (95,2%), mais l’endogamie reste très forte, en particulier dans les zones sunnites. En revanche, en Egypte, l’alphabétisation a pris du retard (73,2%), mais l’endogamie, déjà pas très élevée, est en chute libre. Il est probable que les dirigeants de ces deux pays regardent ce qui se passe en Tunisie avec beaucoup d’attention…